Nous arrivons au terme de notre voyage autour du tissu. Après avoir filé les fibres et tissé les fils, nous avons obtenu un tissu brut. Il ne nous reste plus qu'à l'apprêter.

La teinture consiste à fixer une couleur sur un matériaux. Ce dernier peut-être du bois, du cuir, du tissu ou même votre peau ou vos cheveux. Ce qu'on appelle teinture est le colorant lui-même. Il va donc y avoir des teintures chimiques et des teintures naturelles, chacune se fixant au support à sa façon.
Comme toujours, je vais commencer.... Par un bout d'histoire ! et oui, comment en est-on arriver là ? A cette collection de tissus de toutes les couleurs, avec tout un tas de motifs magnifiques ? Non, parce que, à la préhistoire, ça ne devait pas être très varié... Alors, quel est le chemin parcouru ?
La teinture dans l'histoire
La Préhistoire
Au tout début, il y a encore la préhistoire. L'Homme s'habillait alors de peaux de bêtes pour se protéger du froid. Les 1ers vêtements en textile apparaissent au Néolithique (voir Le tissu 1er volet). Dans le monde entier, l'Homme a alors cherché à colorer ses textiles à partir de substances trouvées dans la nature. Des traces de tissus teintés à l'indigo et vieux de 4500 ans ont été retrouvés au Soudan et en Egypte. En Amérique du sud, des textiles teintés à l'indigotine datés de 6000 ans ont été mise en évidence par des chercheurs en 2016. Comme vous pouvez le voir, l'histoire de la teinture remonte très loin dans l'histoire de l'humanité.
Qu'est-ce que l'indigotine ? C'est une teinture extraite de la guède, ou Pastel des teinturiers pour les Europeens ((Isatis tinctoria, plante à fleurs jaunes). En France, l'Isatis était particulièrement cultivée à Toulouse et dans le nord à Amiens où on l'appelle la waid. L'Isatis n'a pas besoin de mordant pour se fixer au tissu (le mordant est une substance permettant au tissu d'être plus "disponible" à la pénétration de la couleur). C'est la raison pour laquelle elle a pu être utilisée très tôt. Lorsqu'un tissu est teinté avec l'Isatis, il est tout d'abord jaune, comme les fleurs de la plante. La couleur bleu indigo se révèle après oxydation du colorant par exposition du textile à l’air
L'Antiquité
Avançons un peu dans le temps et arrivons dans une autre grande période de l'histoire : l'Antiquité. L'Antiquité suit directement la préhistoire puisqu'elle démarre vers -3300 avec l'invention de l'écriture (qui marque le début de l'histoire). Cette période couvre la période des grandes civilisations, comme celles d'Egypte, de Rome, de Mésopotamie, de Grèce ou l'empire Byzantin. Elle se termine avec le début du Moyen Age au 5ième siècle.
Durant l’Antiquité, la nature continue à fournir la totalité des colorants textiles. A cette période, la teinture du bleu est largement maîtrisée. Pour les hommes de l'Antiquité, les techniques de teintures de cette couleur sont déjà considérées comme ancestrales. Durant cette période, une nouvelle couleur va faire son apparition sur les tissus : le rouge. Et pas n'importe quel rouge : le rouge pourpre, celui des empereurs ! Cette couleur est produite à partir d'un coquillage, le Murex et a été découverte par les Phéniciens. Le rouge est très difficile à produire, c'est une couleur réservée à l'élite et utilisée comme produit de luxe en Grèce, en Egypte, dans l'empire Romain et en Perse. Plus tard, ce rouge mélangé à du bleu pourra fournir des violets.
En Provence et dans le Languedoc, on commence à produire du kermès, un colorant rouge vif extrait d’insectes vivant sur les chênes.
L'époque médiévale
Le Moyen-age démarre au Vième siècle, il suit directement l'Antiquité. Il commence à la fin des grandes invasions barbares, alors que l'empire romain est en plein déclin. Sur le trône de France se trouvent les Mérovingiens, qu'on appelle aussi "les rois fainéants" parce qu'ils voyageaient couchés dans des litières.
Les Capétiens succèdent au mérovingiens au 10ième siècle avec l'avènement d'Hugues Capet en 987. Ils règneront durant tout le reste du Moyen Age jusqu'à la guerre de 100 ans, soit pendant 10 siècles. L'époque médiévale prend fin au 16ième siècle avec le début de la Renaissance.
Le saviez-vous ? Le Moyen Age doit son nom aux personnes de la Renaissance. Ces derniers percevaient le Moyen Age comme une période barbare, médiocre, un age moyen située après un age d'or : l'Antiquité gréco-romaine. Et probablement aussi avant une époque magnifique, la leur !
Au Moyen Age, la teinturerie s'est beaucoup développée. C'est un métier d'artisanat, en conséquence, il s'agit d'un métier très réglementé. Les teinturiers sont réunis dans la guilde des teinturiers. Au sein de cette corporation, on trouve les teinturiers de rouge et les teinturiers de bleus. ces derniers sont les seuls à avoir le droit de teindre et sont très jaloux de leurs droits, ce qui leur vaut de fréquentes altercations avec les drapiers et les tisserands qui aimeraient bien se passer d'eux !
A cette époque, les procédés de teinture sont encore mal maîtrisés. Les couleurs
obtenues ne sont pas forcément de la teinte attendue (pas le bon bleu ou le bon rouge), et tiennent très mal au lavage. La teinturerie apparaît comme un univers nauséabond, malsain et incompréhensible. La plupart des produits de teinturerie ont des odeurs puissantes, nauséabondes. Leur fabrication utilise des produits peu hygiéniques, comme l'urine. En bref, ce métier est nocif pour celui qui le pratique et pour l'environnement.La teinture demande beaucoup d'espace, du combustible et beaucoup d'eau. Les quartiers des teinturiers se trouvent donc en périphérie des espaces habités, ou sur des promontoires venteux.
Au Vème siècle, au début du Moyen Age, le Murex, surexploité est en voie de disparition. Il devient impossible de produire le rouge pourpre. Cependant, des rouges plus vifs sont produits à partir du kermès et des racines de Guarance (ci-dessus). Le bleu est toujours produit à partir de l'isatis et de la waid, toujours cultivé en masse dans le toulousain et l'amienois. La nouveauté vient de l'apparition de teintures jaunes créées à partir du genêt, de la callune, du fustet, de l’épine-vinette, du mûrier et du réséda. Mélangée au bleu de l'isatis et de la waid, cette teinture permet maintenant d'obtenir du vert !
La teinture en France à l’époque moderne
L'époque moderne suit le Moyen Age et démarre à la fin de la guerre de 100 ans avec la Renaissance et François Ier. Elle se prolonge ensuite dans le temps jusqu'à nous.
A la fin du Moyen Age, une gamme de couleur réduite, mais suffisamment variée a été établie. Le métier est organisé en guilde, il est réglementé et les teinturiers sont protégés. Du point de vue de la qualité des couleurs par contre, des progrès restent à faire.
Tout au long de la Renaissance, les choses évoluent peu, et surtout très doucement. A partir du 17ième siècle, tout va s'accélérer de plus en plus vite, particulièrement au 19ième siècle en faveur de la révolution industrielle.
- Au 17ième siècle, Jean-Baptiste Colbert, 1er ministre de Louis XIV, décide de modifier l'organisation de la guilde des teinturiers. Il veut que les artisans puissent se spécialiser dans une teinture de qualité. Il émet donc une ordonnance règlementant les teintures bas de gammes (ou "petit et faux teint"), et les teintures haut de gamme (ou "grand teint").
Rapidement des progrès sont constatés et les textiles grand teint se caractérisent par leur résistance au lavage à la lumière et au chlore). Ils assurent la renommée des étoffes françaises colorées, même à l’étranger.
- Au milieu du 18ième siècle, le monde de la science s'intéresse de près à la chimie, domaine dans lequel les progrès sont très rapides. Les études menées sur la teinture permet une meilleure compréhension des procédés utilisés. Ces derniers sont améliorés, , des colorants d'origine minérales font leur apparition comme le brun de manganèse, le bleu de Prusse ou l'orange d'antimoine. On utilise désormais les colorants avec des "mordants", c'est à dire des composés chimiques facilitant l'accroche du colorants sur la fibre. Pour être honnête, certains mordants sont déjà utilisés depuis la préhistoire, comme l'urine. Le 18ième siècle voit le développement de l'utilisation des sels métallique comme mordants, bien plus efficaces.
Pour résumer, le 18ième siècle voit un développement importants des couleurs, mais également une évolution des techniques de teintures permettant des teintures plus solides.
- Le 19ième siècle arrive. Comme chacun le sait, le 19ième siècle n'est pas marqué que par les guerres napoléoniennes (même si on en parle beaucoup). Le 19ième siècle, c'est aussi une ère de progrès et d'immenses avancées scientifiques. L'évolution de la chimie organique permet l'apparition de la teinture synthétique qui se développe à la vitesse de l'éclair et provoque le déclin de la teinture naturelle utilisée depuis des siècles. Cette teinture a de nombreux avantages :
- Elle peut être produite en grande quantité (en très grande quantité même !).
- Elle existe en plus de 4000 teintes (les colorants naturels n'en proposent que 12 !)
- Une fois la formule déterminée, on peut la fabriquer à l'infinie (Certaines teintures naturelles disparaissent à cause de la disparition de l'espèce, ou parce que la matière première est trop difficile d'accès)
- Elle convient aux fibres synthétiques inventées au début du 20ième siècle (pas les teintures naturelles)
- Nous terminons notre voyage au 21ième siècle. Au cours du 20ième siècle, le marché de la mode a connu l’essor que l'on sait. Mais surtout, une prise de conscience s'est faites dans la 2ième moitié du siècle : et notre planète dans tout ça ? La teinturerie n'a pas fait exception : les consommateurs occidentaux sont préoccupés par l'impact des colorants synthétiques sur la santé et l'environnement. Il existe une demande croissante pour des produits utilisant des colorants naturels. Après un siècle de délaissement, ils reviennent en force 😊
Et la teinture alors ?!
La teinture est un processus qui se déroule en 3 étapes :
- La préparation du tissu
- La couleur
- l'apprêt
La préparation du tissu
- Désencollage : le désencollage permet d'enlever l'amidon et la colle du tissage qui reste sur le tissu qui empêcheront la teinture de bien se fixer.
- Blanchiment : la fibre de coton est mate. L'objectif du blanchiment est de l'éclaircir. Cette étape est indispensable pour les teintures claires.
- Mercerisage : le mercerisage est une technique qui consiste à traiter le tissu à la soude caustique pour donner un aspect lustré à la fibre de coton. Ce procédé, inventé par John Mercer en 1844, avait le défaut de faire rétrécir le tissu. Il est donc très peu utilisé jusqu'à ce que, en 1890, Horace Lowe aie l'idée d'étirer le tissu après le rinçage quand ce dernier est encore humide. Il réduit alors fortement le rétrécissement du tissu et crée ainsi le coton perlé. Lors de ce procédé, la fibre gonfle, ce qui permet à la teinture de mieux pénétrer à l'intérieur. La couleur obtenue est alors plus brillante.
Ce procédé est applicable à des tissus stables et non déformables. Typiquement, on ne peut pas l'utiliser sur de la laine.
- Desembouillage : le désembouillage est appliqué aux cotons. Il permet d'enlever la paraffine, les graisses, les salissures, l'amidon, les cires et les débris de végétaux qui sont pris dans la fibre et qui seraient responsables d'une inhomogénéité de la teinture.
Ces procédés de préparation du tissus sont les principaux procédés utilisés. Il en existe de nombreux autres en fonction du tissu sur lequel on travaille, ou du résultat voulu. Je peux citer ici le décreuzage qui permet d'éliminer le grès de la soie naturelle, le flambage qui élimine les fibres plucheuses, ou le gauffrage qui modifie la surface du tissu.
Tous ces traitements ont pour but de rendre le tissu propre, d'enlever les impureté, et de rendre les fibres les plus lisses possibles. A ces conditions, et à ces conditions seulement, la teinture sera de qualité et pérenne.
La couleur
Le tissu est à présent prêt pour la teinture proprement dite.
Le processus essentiel de teinture consiste à tremper le matériau contenant le produit colorant dans l'eau afin d'obtenir le bain de teinture, puis à y ajouter le textile à teindre.
Quand des couleurs végétales sont utilisées, il est souvent nécessaire d'ajouter des mordants au bain de teinture. Dans la teinture traditionnelle, les mordants communs sont le vinaigre, le tanin de l'écorce de chêne, le sumac (ou les galles du chêne), l'ammoniac de l'urine ventilée, et la potasse (carbonate de potassium) du bois. Aujourd'hui, on utilise également la betterave, la banane et le symplocos.
Les colorants
Les colorants pénètrent en profondeur dans la fibre. Si il a des affinités avec le matériaux, il s'y fixe. Dans le cadre des tissus, chaque type de fibre a des affinités avec un ou plusieurs types de colorants.
Pour fabriquer des colorants, le principe de la synthèse soustractive est utilisé. Quesaco ? Prenez n'importe quel objet, par exemple ce téléphone jaune sur gettyimages (oui, je fait dans le retro ! J'ai connu se téléphone, on ne se moque pas !).
Que ce passe t-il ? La lumière ambiante (ou lumière incidente pour les physiciens) vient taper sur le téléphone. La lumière ambiante est blanche, mais elle se décompose en plusieurs couleurs (ou longueur d'onde pour les physicien), celles de l'arc en ciel.
Lorsque la lumière ambiante vient frapper un objet, ce dernier absorbe certaines longueurs d'onde. Les autres continuent tranquillement leur chemin. Le téléphone jaune absorbe toutes les longueurs d'onde qui s'éloigne du jaune. Elles les soustraits à la lumière ambiante et la lumière qui atteint notre oeil est... Jaune ! Bon, c'est un peu imagé, mais ça représente pas trop mal ce qu'il se passe. Pour une explication plus détaillée, la page wikipédia est très bien faite !
Les pigments
Les pigments existent depuis la nuit des temps, et ils sont utilisés depuis la préhistoire, comme on l'a vu plus haut.
Les pigments sont d'origine diverses :
- animale comme la cochenille
- géologique comme l'ocre, la bauxite, le fer, le sable, le cuivre, le lapis-lazuli, ...
- organique comme la garance et l'indigo
Ils sont généralement insolubles dans l'eau et ont donc besoin de solvants. En peinture, on utilise par exemple l'huile de térébenthine. Pour finir, les pigments ne pénètrent pas à l'intérieur de la fibre, ils se déposent à la surface. Ils sont donc plus adaptés à l'impression qu'à la teinture.
Les pigments sont plutôt utilisés dans le cadre de la teinture artisanale, alors que les colorants se retrouvent plutôt dans l'industrie. Cependant, avec la prise de conscience de notre impact de nos actes sur l'environnement, la teinture artisanale, plus naturelle revient en force et s'impose tranquillement dans l'industrie de masse.
Les procédés de teinture
Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types de machines utilisées pour la teinture, ce serait fastidieux. Sachez cependant qu'il existe un excellent livre intitulé "technologies des textiles" de Daniel Weidmann dans lequel vous pourrez trouver toutes les explications, et même plus !
Revenons à la teinture. Il existe 2 procédés de teinture :
En discontinu ou par épuisement : Le tissu est tout d'abord pesé. Le bain de teinture est dosé à partir du poids mesuré, puis le tissu est plongé dedans pendant un certain temps. Le bain est ensuite vidé, et le tissu lavé.
En continu ou semi-continu : cette technique permet un rendement très important. Le tissu est directement plongé dans le bain de teinture sans pesée préalable. La couleur est ensuite fixée par un mordants, puis le tissu est lavé.
Les apprêts
Après la teinture, les étoffes sont séchées puis repassées. Il reste ensuite une dernière étape : l'apprêt. De quoi s'agit-il ? Et bien, tout simplement d'apprêter le tissu avant de le mettre en vente. Il faut qu'il soit joli, solide, stable, et réponde à vos besoin.
Une fois séché et repassé, le tissu a besoin d'être stabilisé. On le fait passer dans des tunnels qui le chauffe à haute température afin de le fixer et de finir de le sécher en profondeur.
Il reste à présent à le rendre "joli". Pour des tissus lisses comme les cotons, il n'y a rien à faire, il est déjà beau comme il est ! Par contre, les mailles sont moins présentables. On va les gratter avec des pointes métalliques afin de créer un aspect duvet bien douillet. On peut également les tondre afin de couper les boucles et les bouclettes qui dépassent et donner un aspect velours ou polaire au tissu.
Pour certains tissus, d'autres traitements seront appliqués. Le but est de répondre à des besoins spécifiques. Ces apprêts sont des apprêts chimiques et non mécaniques ou thermiques comme les précédents. Ces apprêts pourront par exemple rendre les tissus infeutrables, infroissables, ignifugés, imperméabilisants, hydrofuges, antistatiques, antimites, ...
C'est la fin de cette petite série sur les tissus. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le découvrir en détail. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Mais j'y reviendrais !















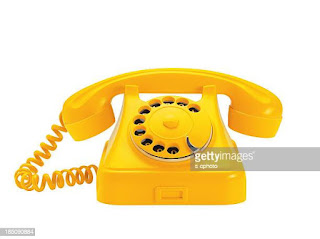


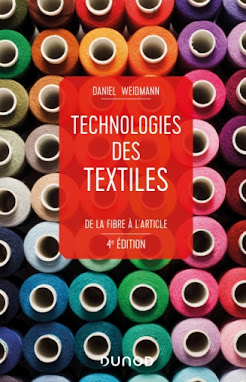

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire